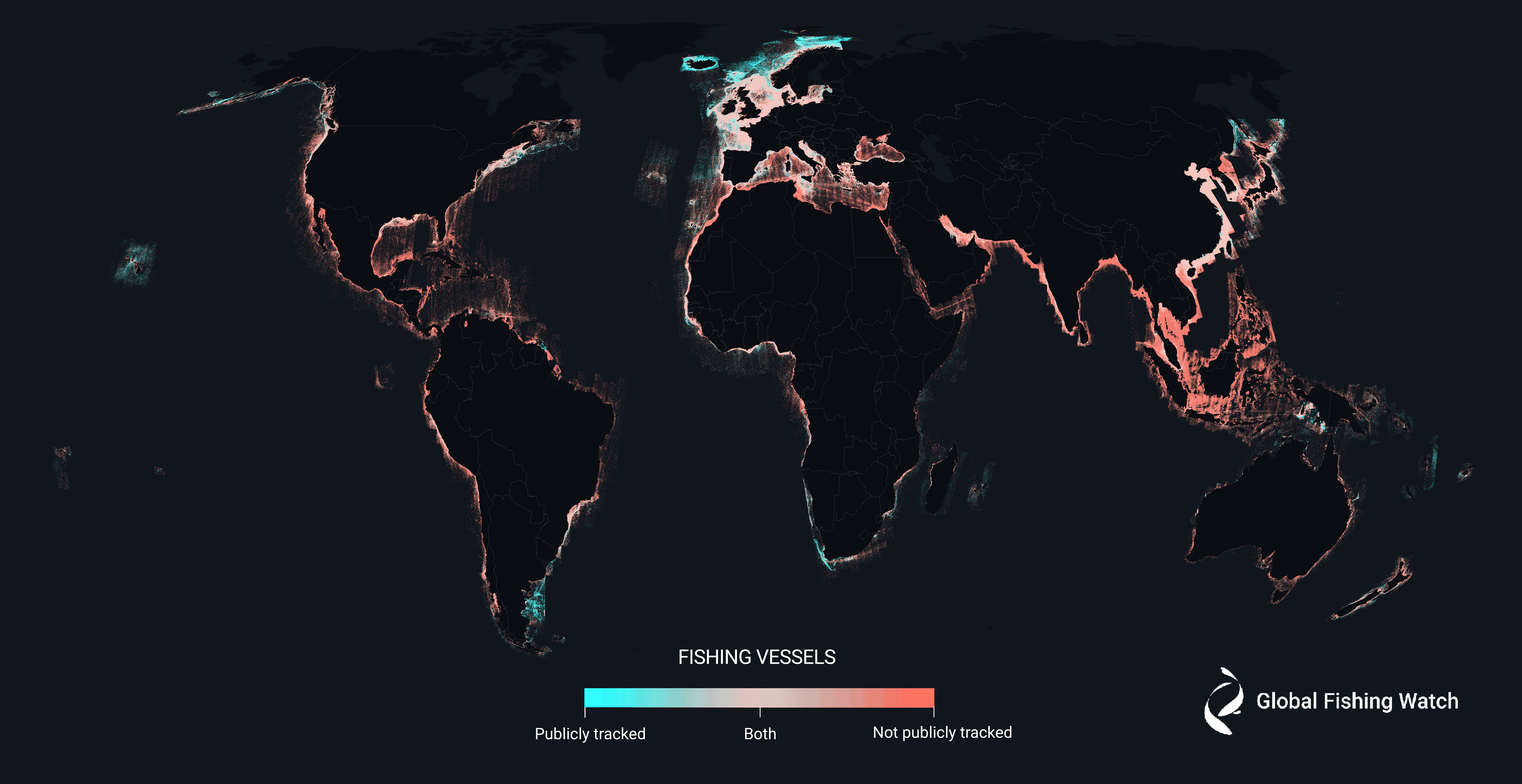Olivier Besancenot : « Le danger fasciste est réel »
Lucide sur l’avancée de l’extrême droite, l’ancien candidat d’extrême gauche à la présidentielle appelle à refuser la « dictature du fait accompli » : à condition d’éviter le sectarisme, le camp de l’émancipation peut se ressaisir.
Mathieu Dejean
16 janvier 2024 à 12h37
MobilisationMobilisation contre la loi immigration, divisions à gauche, monde en bascule avec l’ascension des discours et de forces d’extrême droite en Europe... L’ancien candidat à la présidentielle de la Ligue communiste révolutionnaire (LCR) en 2002 et 2007 (il avait obtenu respectivement 4,25 % et 4,08 % des suffrages exprimés), désormais simple militant au Nouveau Parti anticapitaliste (NPA), qui a récemment proposé à La France insoumise (LFI) de faire liste commune aux élections européennes de 2024, porte un regard inquiet sur la situation en France et dans le monde.
Sans céder aux « fatalistes de l’Histoire » qui veulent imposer le récit d’une victoire inexorable de Marine Le Pen en 2027, il alerte sur ce « danger réel » et invite toutes les forces de gauche à reprendre le flambeau de l’antifascisme « au-delà de la seule question électorale ».
Mediapart : La loi immigration est passée fin décembre avec les voix du RN. Même si le Conseil constitutionnel censure certains de ses articles, considérez-vous qu’on est passé à une nouvelle étape dans l’évolution du macronisme ?
Olivier Besancenot : Cette loi marque un saut majeur dans l’extrême droitisation de la classe politique, c’est évident. Son élaboration témoigne de l’influence du Rassemblement national, qui est devenu une boîte à idées du pouvoir en place. Cela crédibilise un peu plus la thèse de l’accession possible du RN au pouvoir, même si l’extrême droite n’y est pas encore.
Sur la loi immigration, la bataille n’est pas terminée. Après la manifestation du 14 janvier, il y aura celle du 21 janvier. Nous allons unifier un maximum de forces et faire entendre la voix de toutes celles et tous ceux qui y sont opposés. Les macronistes traîneront cette loi comme un boulet, y compris lors d’échéances symboliques comme l’entrée de Manouchian au Panthéon. Car faire entrer au Panthéon l’un des responsables des Francs-tireurs et partisans – Main-d’œuvre immigrée (FTP-MOI) et faire voter cette loi, ce n’est pas du « en même temps » mais une contradiction politique scandaleuse et moralement révoltante.
Aux coups portés par le camp présidentiel sur la question sociale, dans une ambiance internationale sombre, pourraient susciter davantage d’abattement que de révolte. Comment percevez-vous le climat du pays ?
Un récit nous est imposé sur le thème de l’inexorable ascension du RN au sommet de l’État. Je suis plutôt du côté du révolutionnaire Auguste Blanqui, qui pourfendait les fatalistes de l’Histoire. La responsabilité première à gauche, quelle que soit sa sensibilité, est de refuser cette dictature du fait accompli et de faire en sorte que ce récit soit démenti par les faits. Je suis conscient de l’évolution du rapport de force, et je sais qu’on ne l’inversera ni par des postures ni par de la gonflette, mais l’Histoire n’est pas une construction linéaire, elle est faite de bifurcations.
Il faut rassembler les forces sur des batailles essentielles, dont la lutte contre l’extrême droite et ses idées. S’il existe un drapeau qui permet de rassembler toute la gauche sociale et politique anticapitaliste, c’est le drapeau commun de l’antifascisme. Un tournant mondial nauséabond s’opère, auquel il faut opposer un large front d’actions et de résistance à l’air du temps.
À quoi attribuer ce tournant qu’on constate en Europe, mais aussi en Amérique latine avec Javier Milei en Argentine, ou en Israël avec Nétanyahou ?
Ce qui se passe en Israël, ce qui se passe en Europe et ce qui se passe en Amérique latine, au-delà des singularités propres à chaque situation, témoigne de la fin d’un cycle. Celui de la mondialisation libérale telle que nous l’avons connue depuis 40 ans, et cela renvoie aux contradictions profondes et inhérentes au système capitaliste.
Comme toujours, une fin de cycle n’est pas synonyme de retour à la situation antérieure : c’est une situation nouvelle qui s’ouvre, marquée par des intérêts nationaux aiguisés, des compétitions inter-impérialistes et des guerres locales de très haute intensité qui mettent en péril le reste du monde à chaque instant. C’est comme si le monde avait perdu le contrôle de sa propre marche, comme un train fou qui roulerait à vive allure vers un précipice. La catastrophe écologique et climatique, ou même la récente crise liée au narcotrafic en Équateur, vont dans ce sens.
Nous ne vivons pas une redite des années 30, car ce n’est pas tant le “péril rouge” qui inquiète la classe dominante que le désordre globalisé qui menace ses affaires. Mais le danger fasciste est réel.
Politiquement, cela produit des courants d’extrême droite, néofascistes ou fascistes – l’heure n’est plus aux colloques sur leur dénomination. Marx comparait la révolution à un train qui tire l’humanité vers l’avant. Walter Benjamin, lui, tout en faisant sienne la rhétorique marxienne, comparait la nécessité révolutionnaire au signal d’alarme de ce train que l’humanité devait tirer au plus vite et en conscience, avant qu’il ne s’écrase. La tâche du mouvement d’émancipation tient aujourd’hui précisément à cela : tirer ce signal d’arrêt-urgence !
L’extrême droite a fortement progressé tant électoralement que sur le plan culturel depuis 2002, où l’extrême gauche représentait un débouché politique important – avec Arlette Laguiller de Lutte ouvrière, vos deux candidatures cumulaient 10 % des suffrages exprimés à la présidentielle. Comment expliquer cette extrême droitisation, et le fait que la gauche de rupture soit moins identifiée comme un débouché politique aujourd’hui ?
D’abord, il y a eu des défaites sociales sur le terrain de la lutte de classe, dont très récemment celle sur la bataille des retraites. Dans ces circonstances, l’idée que la solidarité paye est plus compliquée à démontrer. Les discours émancipateurs ne sont jamais aussi forts que lorsqu’ils sont portés par des périodes de victoires par l’action. Or, compte tenu de la crise globale que nous traversons, les luttes ne sont pas derrière nous. Tout reste ouvert.
Mais il y a aussi des tendances de fond, notamment une aspiration à l’ordre que les discours simplistes remplissent facilement de haine. Hannah Arendt l’a analysé à maintes reprises : il existe une base sociale au mouvement totalitaire, qui ne s’explique pas seulement par le haut et le jeu des classes dominantes. Elle évoque un terreau : un phénomène de « désolation », sorte de stade suprême de l’individualisation et de la fragmentation des relations sociales. Face à cela, tout projet émancipateur doit partir de cette terrible réalité pour espérer être en phase.
Dans ce contexte, nous sommes obligés de tirer les bilans de notre propre histoire, même si celle-ci ne se répète jamais à l’identique. Nous ne vivons pas une redite des années 30, car ce n’est pas tant le « péril rouge » qui inquiète la classe dominante que le désordre globalisé qui menace ses affaires à terme. Mais le danger fasciste est réel du point du vue du racisme anti-immigrés et des attaques antidémocratiques. Les erreurs tragiques du mouvement ouvrier propres aux années 30, elles, menacent de se reproduire à l’identique : le sectarisme, la fragmentation, l’aveuglement.
C’est cette analyse qui a conduit le NPA à proposer une campagne commune avec LFI aux européennes de 2024 ?
Je ne suis plus à la direction du NPA, mais j’accompagne cette démarche qui consiste en effet à interpeller les forces de la gauche de rupture. Cela étant, au-delà de la seule question électorale, il y a une nécessité de dépassement et de rassemblement des forces sociales et politiques anticapitalistes, tout en plaçant au centre le front unique contre la droite et l’extrême droite. Une unité sur une démarche d’actions concrètes qui puisse alimenter le retour nécessaire des questions stratégiques pour incarner une alternative de masse – ce que nous n’avons pas réussi jusqu’ici.
L’extrême droite mène à sa manière une bataille pour l’hégémonie culturelle de manière décomplexée depuis 30 ans ! À nous de mener la nôtre. Pour l’heure, nous traversons un énorme trou d’air idéologique où les gauches en France semblent perdre leurs boussoles, au point de devenir parfois méconnaissables...
En termes de ligne politique. Pendant longtemps, la lutte contre le racisme, sous toutes ses formes, était un repère politique structurant à gauche. De l’affaire Dreyfus aux générations qui ont écrit les pages de la Résistance et du mouvement ouvrier, sans oublier la marche pour l’égalité des années 80. Ce combat inclut autant la lutte contre l’antisémitisme, l’islamophobie que la négrophobie. Cette boussole à gauche est fondamentale, au même titre que l’a toujours été la lutte anticoloniale – je pense au Vietnam ou à l’Algérie par exemple.
Or, depuis le 7 octobre dernier, les gauches paraissent perdre le nord, comme si les aiguilles s’affolaient au point de renoncer à l’une ou l’autre de ses valeurs. Idem sur l’internationalisme, victime du triste retour du « campisme » qui voudrait transformer en loi la maxime qui prétend que « l’ennemi de mon ennemi est forcément mon ami ». C’est la même cohérence qui nous pousse, au NPA, à affirmer notre solidarité à la fois pour la résistance palestinienne, kurde ou ukrainienne, par exemple.
La gauche a en effet été accusée d’antisémitisme, de complicité avec le Hamas dans cette période, et le NPA n’y a pas échappé. Y a-t-il eu des maladresses, quand vous relisez les événements depuis le 7 octobre ? Avez-vous réussi à tenir tous les bouts ?
J’appartiens à un courant politique, la IVe Internationale, où des camarades ont été porteurs de valises pour le FLN, remplies d’argent ou d’armes. C’était notre contribution à la lutte d’indépendance algérienne. Pour ma part, j’en tire une grande fierté. Cela ne nous empêchait pas à l’époque de formuler nos désaccords, voire des critiques sur certaines modalités d’actions. Nous étions par exemple opposés aux attentats aveugles contre les civils. Des questions morales d’autant plus importantes qu’une des conditions pour qu’une lutte de libération nationale l’emporte, c’est que la société coloniale, elle-même, se fracture.
L’accusation d’apologie de terrorisme qui nous est faite est une insulte à notre histoire.
En outre, le Hamas n’est pas le FLN. Nous sommes pour le droit à l’autodétermination du peuple palestinien, parce que nous sommes pour son droit à l’émancipation. Or le projet du Hamas est à l’opposé, point par point, d’un projet d’émancipation. Pour nous, les massacres contre les civils, les corps souillés ou les viols ne seront jamais des actes de résistance mais des actes de barbarie. Je les ai toujours dénoncés. Le 7 octobre 2023 n’échappe pas à la règle.
Du reste, l’accusation d’apologie de terrorisme qui nous est faite est une insulte à notre histoire. Ici comme ailleurs, je ne ferai jamais mienne la devise qui affirme que « la fin justifie les moyens ». Les contre-révolutions bureaucratiques du XXe siècle sont toutes nées en ânonnant joyeusement ce genre de slogan. Et précisément parce que, dans chaque situation, nous plaçons la vie humaine au-dessus de toute chose, les silences politiques assourdissants sur le massacre qui se déroule à Gaza me glacent le sang.
Il y a un côté orwellien dans la situation actuelle, quand on écoute les mots qui sont utilisés. Ce n’est pas d’une guerre d’occupation coloniale qu’il serait question mais d’une « opération militaire pour éradiquer le terrorisme », donc d’une opération de paix – on n’est pas loin de « la guerre, c’est la paix » dans le roman d’Orwell. On peut multiplier les exemples : on criminalise le simple fait de participer, comme je l’ai fait, à des manifestations de solidarité avec le peuple palestinien pour réclamer le cessez-le-feu. Brandir le drapeau palestinien serait désormais considéré comme un signe antisémite ! C’est du délire.
Un porte-parole de l’armée israélienne a promis des combats à Gaza « tout au long de cette année 2024 ». On ne peut pas dire qu’en France la mobilisation pour la solidarité soit aussi massive que dans d’autres pays. Comment peser pour que cessent les massacres ?
Une responsabilité considérable pèse sur nous pour que la solidarité s’organise ici, dans les pays les plus riches. La mobilisation qui se déroule aux États-Unis, notamment les manifestations juives qui proclament « Pas en notre nom ! », est extrêmement importante de ce point de vue. Ces luttes exercent une pression au cœur même de la puissance protectrice de l’État colonialiste israélien.
Pour qu’une solution politique binationale voie le jour là-bas, avec égalité des droits pour tous et toutes – deux États, un État, un système fédéral… –, il faut, en complément de la lutte palestinienne, que la solidarité s’organise dans nos pays pour imposer à nos gouvernants de retirer à Israël tout appui logistique, économique et militaire, et mettre fin à l’horreur à laquelle nous assistons chaque jour, impuissants.
On a besoin d’un sursaut de conscience politique et que la gauche sorte de sa léthargie. Malheureusement, la gauche française paraît trop souvent prisonnière des règles de la Ve République. Une campagne présidentielle se termine, et les futurs candidats à la prochaine se profilent d’emblée. Trop de remplaçants sur le banc, qui ne pensent qu’au brassard de capitaine et plus vraiment à l’équipe. Au foot, ça finit toujours mal. Jouer collectif, c’est taper ensemble sur les mêmes clous, même lorsque nous marchons séparément, pour reprendre la vieille formule !
Le pire des risques pour la gauche aujourd’hui, c’est donc le sectarisme ?
Il ne faut céder ni au sectarisme ni à l’opportunisme. Affirmer sa solidarité avec le peuple palestinien est un minimum, quelle que soit son obédience, et quelles que soient les pressions exercées par le courant dominant. Nous avons, par exemple, des désaccords politiques connus avec LFI, mais la diabolisation et la cornérisation dont cette organisation fait l’objet devraient tous nous alerter.
De même, lorsque le NPA a été convoqué par la police judiciaire et entendu dans le cadre d’une enquête préliminaire pour « apologie du terrorisme », les soutiens ont été discrets. La gauche peut s’en laver les mains, ou se les frotter, sur le thème « ils l’ont bien cherché », mais si par malheur le cours politique dominant réussissait à nous mettre au ban, c’est tout le mouvement ouvrier et syndical qui pourrait être emporté par la suite. Et même une partie de la Macronie – souvenez-vous de cette scène où le député RN Laurent Jacobelli traite de « racaille » le député de la majorité Belkhir Belhaddad…
Loin des écuries présidentielles, il existe pourtant un renouvellement dans les combats de l’heure, marqués par une nouvelle génération qui s’est exprimée dans les luttes ouvrières, dans le syndicalisme, sur le terrain de l’écologie avec les Soulèvements de la Terre, dans les luttes LGBT… Les potentialités et les ressources existent. Mais en se privant sciemment d’horizons et d’espérances politiques, au nom des petits calculs électoralistes de la Ve République, la gauche continuera à creuser sa propre tombe avec enthousiasme.
J’espère que la bataille sur la loi immigration nous servira d’électrochoc. Et que le danger fasciste nous poussera à nouveau à nous serrer les coudes. Être révolutionnaire, répétait Alain Krivine, c’est aussi résister au fait de devenir cynique ou blasé. Nous sommes nombreuses et nombreux à avoir un rôle à jouer pour qu’un courant anticapitaliste, unitaire, large, fasse entendre sa voix.
Mathieu Dejean